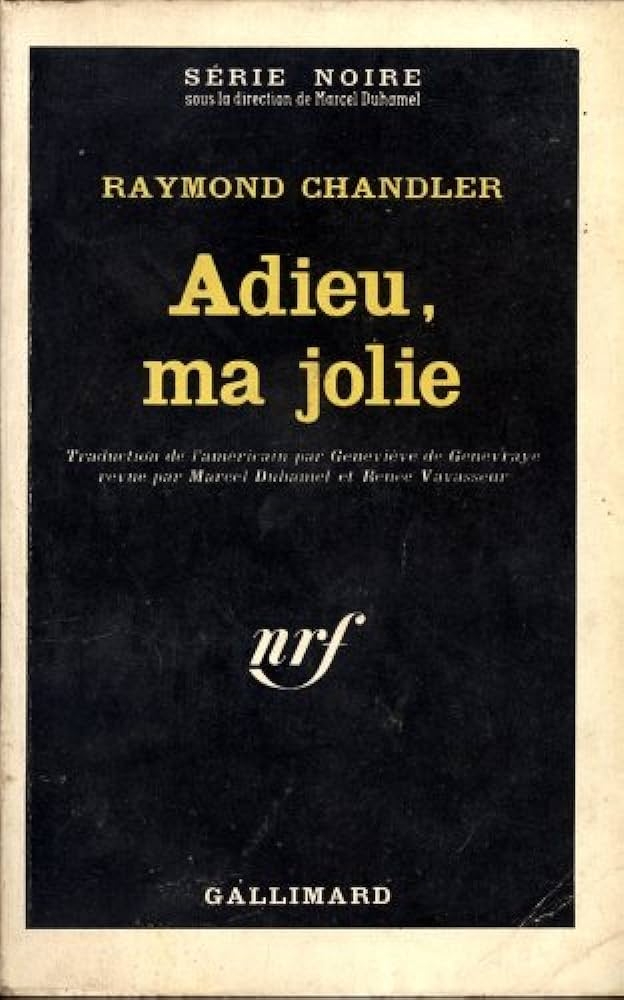A toi de faire, ma mignonne
Voir la page du Musée Picasso présentant cette exposition ici.
Repris par Sophie Calle pour cette exposition, c’est le titre d’un roman policier de Peter Cheney, paru dans la Série Noire sous le numéro 21, en 1949.
Noir… En voyant l’air maussade de la gardienne des premières salles du musée, on se demande si les couleurs de Picasso ont disparu, dissoutes dans une époque bien sombre…

Question légitime, d’autant plus légitime que la visite commence par une salle où Sophie Calle a recouvert de papier kraft les tableaux de Picasso, souvenir d’un temps pas si lointain, celui des confinements Covid.

Bon. Le papier kraft, c’est vraiment triste. Pour égayer un peu l’atmosphère, d’autres tableaux ont été recouverts différemment, de papier blanc. Beaucoup plus élégant. C’est le cas notamment de la « Femme couchée lisant ».

C’est un peu dommage. Je ne connaissais pas l’original, mais il ne m’a pas fallu bien longtemps pour le retrouver sur la toile :

Continuons notre visite. En commençant par le mur que l’artiste a appelé Guernica, Une référence évidente au peintre ibérique sous la forme d’un patchwork d’œuvres diverses, lesquelles avant cette exposition ornaient les murs de sa maison. Plus de 21 m², et des thématiques souvent sombres. Les souvenirs sont des traces du passé. Parcourir l’exposition jusqu’à son terme confirme que la disparition, la mort, sont omniprésentes dans le travail de Sophie Calle.

A côté, dans une vitrine, est-ce aussi un autre souvenir, celui d’une affection perdue, d’un compagnonnage qui n’est plus ? Sans légende, il n’y a pas d’interprétation officielle à cette présentation.

Un peu plus loin, et cette chèvre a déjà été largement diffusée, Sophie Calle a emballé de nouveau en blanc un animal, le bronze de Picasso dont le regard masqué est tourné vers la fenêtre, vers la verdure glacée en ces temps d’hiver du jardin attenant au musée.

Mais ce n’est pas le seul animal blanc de cette exposition surprenante, emballante ! Dans le hall, le loup blanc de Sophie Calle est installé comme un veilleur à ses pieds. Il n’est pas lui emballé, il est empaillé. Aux pieds de sa maîtresse il dévisage de son regard à la fois neutre et acéré les visiteurs qui contemplent cette mise en abyme, une quasi nature-morte.

D’autres disparitions
Il reste encore des tableaux de Picasso dans ce musée. Mais ils ne sont pas directement accessibles, voilés par un linge juste translucide, et seul le visiteur qui les a déjà aperçus pourra les reconstituer grâce au texte qui les recouvre. Pas si simple, l’idée est là, mais la représentation mentale ne rend pas justice au génie du peintre… Mais on est saisi par l’expression de Sophie Calle, par l’expression de ses sentiments explicitement livrés. Vérité ou faux-semblant ?

Couvrir pour mieux guider dans les pensées labyrinthiques de l’artiste est une manière de susciter l’attention du promeneur un peu perdu par l’éclectisme de la plasticienne. Dans une salle à l’étage, des images dissimulées derrière des rideaux invitent à les soulever pour découvrir les raisons des choix photographiques. Personnellement, plusieurs m’ont fait sourire, malgré la tristesse parfois de l’association d’idées qui a guidé le regard lors du déclenchement.

Viennent ensuite deux salles. Dans l’une, les visages d’aveugles stambouliotes, souvent de naissance, font face à la caméra. La question qui leur est posée est de décrire ce que le mot « beauté » évoque pour eux. Dans la seconde salle, dos à la caméra cette fois, des hommes et des femmes contemplent la mer, sur laquelle ils posent les yeux pour la première fois.

La mort, toujours en arrière-plan
En montant vers le second étage, une phrase écrite sur le mur donne le ton. Il s’agit d’un extrait du journal intime de sa mère : « Sophie est tellement morbide qu’elle viendra me voir plus souvent sous ma tombe que rue Boulard », son domicile.
La mort revient, jusqu’à la fin de l’exposition, souvent de manière cocasse, comme pour conjurer le sort.

Le parcours ascendant se referme dans cette grande salle du troisième étage. Le mot de la fin est signé Sophie Calle…

Il ne reste plus au spectateur de cette exposition intime qu’à dire au-revoir. Iconoclaste, Sophie Calle se met en scène sans pudeur, mais toujours avec humour, avec une ironie mordante. Le désespoir s’exprime dans un déluge sardonique d’auto-dérision, presque cruelle sous ses apparences de farce.
J’ai passé un très bon moment à l’occasion de cette visite. Il ne reste plus qu’à remercier l’artiste et à lui fixer rendez-vous dans un au-delà incertain…